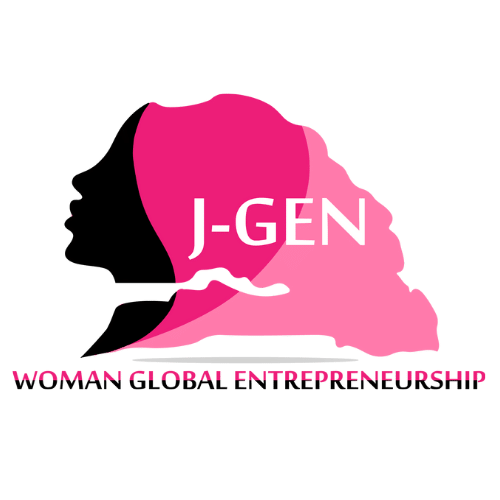Moi, Noire, Musulmane, Féministe
Assiétou Penda Diop KAMARA « Je suis féministe » Aussi longtemps que je me souvienne, cette assertion a revêtu une connotation péjorative, non seulement au Sénégal, mais à travers le monde. Être féministe a été assimilé à une revendication insensée menée par des femmes souvent jugées acariâtres, hystériques et « anticonformistes », dans le but d’acquérir des droits longtemps bafoués ou profondément annihilés par une solide puissance masculine dominatrice, ne souffrant d’aucune équivoque. Être féministe dans mon pays, c’est revêtir la toge d’un avocat du diable. Bien entendu, la métaphore n’est pas difficile à saisir : le diable est la femme, le sexe faible, comme la société a choisi, sans grand effort, de la caractériser. Aujourd’hui encore, les Sénégalais aiment comparer les féministes à des personnes frustrées, n’ayant ni la délicatesse ni le tact requis pour séduire et retenir un homme dans le but strict et « glorieux » du mariage. Dans l’imaginaire commun des Sénégalais, les féministes sont donc cette élite de « vieilles filles », célibataires, qui ont pour la plupart une très bonne condition sociale et qui refusent, (pour une raison évidente qu’est le déni de la subordination légendaire que chaque individu de sexe féminin doit vouer à un homme) de se « conformer » à la norme sociétale. En réalité, revendiquer les droits des femmes et réclamer une égalité parfaite entre les genres humains ne sauraient être le fondement du féminisme. Selon eux, il y a, sans nul doute, une influence occidentale accrue qui chercherait à « pervertir » la société sénégalaise en bouleversant les « us et coutumes de nos ancêtres » bien ancrés dans les « entrailles du patriarcat ». « Nous ne sommes pas des Occidentaux » est certainement la phrase la plus courante qu’un homme ou une femme sénégalaise prononce lors d’une polémique sur la pensée féministe. Beaucoup de femmes ignorent que des acquis politiques et administratifs (à l’instar du droit de vote, du droit de déclarer son enfant né hors mariage, du droit d’aller à l’école, du droit de s’autodéterminer pour le mariage civil, de la loi sur la parité, ou encore de la criminalisation du viol…) qui leur semblent aujourd’hui naturels sont le fruit de longues luttes menées par des féministes noires africaines, souvent au prix du sang. Et au-delà de la revendication exclusive des droits des femmes, ces dernières ont brillamment pris part à des évènements majeurs en y apportant un appui considérable. On peut citer, à cet effet, la lutte pour les indépendances, la grève des cheminots de 1947, etc. On fait souvent recours à la tradition pour demander aux femmes « de rester à leur place ». Le présent a la mémoire courte, car notre histoire nous apprend à quel point la tradition accordait une place d’égale dignité aux hommes et aux femmes. Dans la société lébou, les « ndey ji rew », figures féminines, dirigeaient l’organe de décision et régulaient la communauté afin d’y maintenir l’ordre. Par ailleurs, la société wolof fut foncièrement matriarcale avec la transmission, par le biais de la mère, de l’héritage familial, autant par le nom que par les biens matériels. Nous magnifions aujourd’hui encore la légendaire bravoure des femmes de Nder. C’est certainement grâce à cette « légitimité sociétale » des femmes que la Reine du Walo, Ndatté Yalla Mbodj, en 1855, a pu mener la première résistance face aux colonisateurs français. La prégnance de sa lutte trouve un écho dans le sud du pays avec Aline Sitoe Diatta qui s’opposa fermement à l’invasion étrangère, jusqu’à notre histoire politique contemporaine avec Soukeyna Konaré, connue pour ses passes d’armes avec Lamine Gueye, tout-puissant premier président de l’Assemblée nationale sénégalaise. Ces éléments factuels démontrent l’importante place accordée à la femme dans la société sénégalaise d’antan, mais sont surtout la preuve que les femmes ont toujours semé des germes de changement solides. C’est fort de cet héritage socio-historique que plusieurs mouvements féministes et organisations féminines ont fait leur apparition vers les années 70 et 80 : l’Association des juristes sénégalaises (AJS, 1974), la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS, 1977), l’Association des femmes pour la recherche et le développement (AFARD, 1977), le mouvement Yewu Yewi (1984), etc. Grâce à ce bouillonnement associatif et intellectuel, le Sénégal procédera à la ratification de l’ensemble des conventions relatives aux droits des femmes et jettera les bases politiques et juridiques pour l’égalité femme-homme (SNEEG). Force est donc de reconnaître que les transformations sociales et politiques apparues au Sénégal, impulsées par les combats féministes, ont permis une meilleure représentation des femmes dans les institutions dirigeantes, l’intégration du genre dans les politiques de développement, et la mise en place de mécanismes de promotion féminine. Cependant, malgré ces avancées considérables sur le plan institutionnel, l’absence d’une rupture dans la question de la subordination dans les rapports de genre est palpable. La marginalisation des femmes demeure un fait social indéniable. Ce hiatus entre une base culturelle favorable à la femme et une réalité contemporaine qui l’oppresse s’expliquerait par quelques tournants historiques marquants qui ont quelque peu « déstructuré » le système social sénégalais. Il s’agit de l’arrivée de religions étrangères et de la colonisation française. Les figures féminines mentionnées plus haut (Ndatté Yalla, Aline Sitoe Diatta), ainsi que la pratique matriarcale de la société wolof, s’effacèrent au contact de ces apports culturels et cultuels, entraînant une domination patriarcale. Le mauvais procès fait à la cause féministe proviendrait alors de l’interprétation arbitraire faite par des hommes de certains textes religieux et d’un legs colonial inadapté aux réalités culturelles locales. La transposition de modèles culturels prônant l’exclusion des femmes du système politique et de la sphère décisionnelle, ainsi que la négation de l’accès à la terre pour ces dernières (inspirée, par exemple, de la loi salique du XIVe siècle), a dilué le « pouvoir » des femmes. Cet état de fait se poursuivra jusqu’après les indépendances et s’incrustera dans l’espace socioculturel. Les femmes sont de plus en plus confrontées à des obstacles d’ordre structurel causés par des lois et des institutions discriminatoires
Féminisme en Afrique et en Europe : Mon expérience à l’Université d’Été Féministe d’Afrique de l’Ouest et du Centre
En Europe, en Autriche, d’où je suis originaire, le féminisme met souvent l’accent sur les réformes politiques, l’égalité sur le lieu de travail et la rupture des plafonds de verre, en se concentrant sur les changements systémiques et l’inclusion dans les espaces professionnels. À l’inverse, en Afrique, où je vis et travaille actuellement, le féminisme en Afrique tient compte des contextes culturels, sociaux et économiques uniques du continent, en donnant la priorité à l’autonomisation des communautés, à l’activisme local et à l’intersectionnalité pour aborder des questions telles que l’éducation, les soins de santé et l’indépendance économique L’Université Féministe d’Été d’Afrique de l’Ouest et du Centre Du 1er au 3 août 2024, j’ai eu l’occasion de participer à l’UEF2 (2e édition de l’Université d’été féministe d’Afrique de l’Ouest et Centrale) à Sali, au Sénégal. Pendant ces trois jours, j’ai beaucoup appris sur les nuances du féminisme dans les différentes régions et j’ai écouté des présentations montrant l’importance des solutions contextualisées dans la lutte pour l’équité entre les sexes. J’ai rencontré des féministes extraordinaires d’Afrique francophone, d’Haïti, de France et de la diaspora sénégalaise avec lesquelles j’ai pu établir des liens et comprendre leur important travail et leur impact, où qu’elles se trouvent. J’ai acquis de nouvelles connaissances qui m’ont ouvert l’esprit et m’ont inspirée, en particulier sur les sujets suivants : L’ÉCOFÉMINISME : Une vision entre l’Europe et l’Afrique L’écoféminisme comble le fossé entre l’environnementalisme et le féminisme, en prônant l’interconnexion des questions écologiques et sociales. En Europe, l’écoféminisme se concentre souvent sur les pratiques durables, les politiques vertes et la réduction de l’empreinte carbone, en soulignant le rôle des femmes dans la conduite des initiatives environnementales. En Afrique, l’écoféminisme est profondément ancré dans la lutte contre les effets de la dégradation de l’environnement sur les communautés locales, en mettant l’accent sur l’agriculture durable (y compris la déforestation rapide), la sécurité alimentaire, l’approvisionnement en eau (en pensant à l’hygiène personnelle pendant les menstruations en période de sécheresse) et la préservation des connaissances écologiques traditionnelles. L’écoféminisme présente des perspectives uniques, ce qui souligne l’importance de diverses approches dans la promotion de la justice environnementale et de l’égalité des sexes. Droits des femmes et sécurité des féministes Le paysage des droits des femmes et de la sécurité des féministes militantes varie considérablement entre l’Europe et l’Afrique. En Europe, les militantes féministes agissent souvent dans un cadre de protection juridique et de soutien sociétal, en défendant des questions telles que l’égalité salariale, les droits reproductifs et la représentation politique. En revanche, dans de nombreuses régions d’Afrique, les féministes militantes sont confrontées à des risques plus importants, notamment la répression politique, l’exclusion et l’expulsion de la famille, la stigmatisation sociale et la violence, alors qu’elles ne bénéficient pratiquement d’aucune protection juridique ni d’aucun soutien de la part de la société. Malgré ces difficultés, elles s’attaquent courageusement à des problèmes cruciaux tels que la violence fondée sur le sexe, l’accès à l’éducation et l’autonomisation économique. Cela met en évidence la résilience et les diverses stratégies des féministes du Sud dans leur lutte pour l’égalité et la sécurité. Éducation sexuelle et conscience du corps Il est essentiel, d’un point de vue féministe, d’aborder des questions telles que la conscience du corps, la sexualité, l’éducation sexuelle, les menstruations, les mutilations génitales féminines (MGF) et la pauvreté menstruelle. En Europe, l’accent est mis de plus en plus sur l’éducation sexuelle complète, la positivité du corps et les efforts visant à éliminer la pauvreté menstruelle, soutenus par des politiques et l’acceptation de la société. À l’inverse, dans de nombreuses régions d’Afrique, les féministes sont en première ligne pour combattre des pratiques profondément ancrées comme les MGF, plaider en faveur d’une meilleure éducation sexuelle et lutter contre la pauvreté menstruelle avec des ressources limitées et des défis culturels importants. Ces différences soulignent l’importance des approches contextuelles pour faire progresser les droits et la santé des femmes dans le monde. L’importance de l’intersectionnalité En outre, j’ai appris à quel point la compréhension de l’intersectionnalité est importante et cruciale dans la poursuite d’une véritable égalité et d’une véritable inclusion. J’ai compris que l’intersectionnalité reconnaît que les individus subissent des discriminations et des privilèges de multiples façons, influencés par des identités qui se chevauchent, telles que la race, le sexe, le statut socio-économique, etc. L’adoption de ce cadre nous permet de relever les défis particuliers auxquels sont confrontées les communautés marginalisées et de créer des solutions plus globales et plus efficaces. En reconnaissant et en valorisant les diverses perspectives, nous pouvons construire une société plus équitable et plus inclusive où chacun a la possibilité de s’épanouir. La diversité des luttes féministes Pendant ma participation, j’ai déjà commencé à faire prendre conscience qu’il y a des féministes qui luttent contre différents obstacles dans des délais différents partout dans le monde et qu’il est important d’être une féministe qui se fait entendre, que nous devons nous soutenir les unes les autres (en parlant de la sororité) et qu’ensemble nous pouvons faire changer les choses ! Je continuerai à le faire une fois rentrée chez moi. Je suis très reconnaissante d’avoir pu participer à cet événement et de m’être connectée à un réseau féminin extraordinaire en Afrique de l’Ouest. Je ne peux que vous recommander de participer à l’UEF3 en 2025. Visitez la page de l’UEF :https://universitefeministedete.jgen.sn/