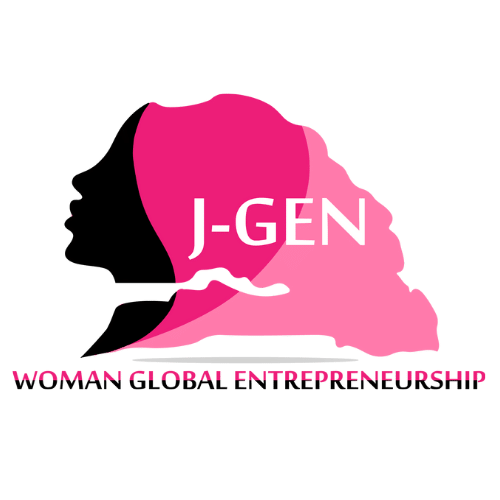Assiétou Penda Diop KAMARA
« Je suis féministe » Aussi longtemps que je me souvienne, cette assertion a revêtu une connotation péjorative, non seulement au Sénégal, mais à travers le monde. Être féministe a été assimilé à une revendication insensée menée par des femmes souvent jugées acariâtres, hystériques et « anticonformistes », dans le but d’acquérir des droits longtemps bafoués ou profondément annihilés par une solide puissance masculine dominatrice, ne souffrant d’aucune équivoque.
Être féministe dans mon pays, c’est revêtir la toge d’un avocat du diable. Bien entendu, la métaphore n’est pas difficile à saisir : le diable est la femme, le sexe faible, comme la société a choisi, sans grand effort, de la caractériser. Aujourd’hui encore, les Sénégalais aiment comparer les féministes à des personnes frustrées, n’ayant ni la délicatesse ni le tact requis pour séduire et retenir un homme dans le but strict et « glorieux » du mariage. Dans l’imaginaire commun des Sénégalais, les féministes sont donc cette élite de « vieilles filles », célibataires, qui ont pour la plupart une très bonne condition sociale et qui refusent, (pour une raison évidente qu’est le déni de la subordination légendaire que chaque individu de sexe féminin doit vouer à un homme) de se « conformer » à la norme sociétale.
En réalité, revendiquer les droits des femmes et réclamer une égalité parfaite entre les genres humains ne sauraient être le fondement du féminisme. Selon eux, il y a, sans nul doute, une influence occidentale accrue qui chercherait à « pervertir » la société sénégalaise en bouleversant les « us et coutumes de nos ancêtres » bien ancrés dans les « entrailles du patriarcat ».
« Nous ne sommes pas des Occidentaux » est certainement la phrase la plus courante qu’un homme ou une femme sénégalaise prononce lors d’une polémique sur la pensée féministe. Beaucoup de femmes ignorent que des acquis politiques et administratifs (à l’instar du droit de vote, du droit de déclarer son enfant né hors mariage, du droit d’aller à l’école, du droit de s’autodéterminer pour le mariage civil, de la loi sur la parité, ou encore de la criminalisation du viol…) qui leur semblent aujourd’hui naturels sont le fruit de longues luttes menées par des féministes noires africaines, souvent au prix du sang. Et au-delà de la revendication exclusive des droits des femmes, ces dernières ont brillamment pris part à des évènements majeurs en y apportant un appui considérable. On peut citer, à cet effet, la lutte pour les indépendances, la grève des cheminots de 1947, etc.
On fait souvent recours à la tradition pour demander aux femmes « de rester à leur place ». Le présent a la mémoire courte, car notre histoire nous apprend à quel point la tradition accordait une place d’égale dignité aux hommes et aux femmes. Dans la société lébou, les « ndey ji rew », figures féminines, dirigeaient l’organe de décision et régulaient la communauté afin d’y maintenir l’ordre.
Par ailleurs, la société wolof fut foncièrement matriarcale avec la transmission, par le biais de la mère, de l’héritage familial, autant par le nom que par les biens matériels. Nous magnifions aujourd’hui encore la légendaire bravoure des femmes de Nder. C’est certainement grâce à cette « légitimité sociétale » des femmes que la Reine du Walo, Ndatté Yalla Mbodj, en 1855, a pu mener la première résistance face aux colonisateurs français. La prégnance de sa lutte trouve un écho dans le sud du pays avec Aline Sitoe Diatta qui s’opposa fermement à l’invasion étrangère, jusqu’à notre histoire politique contemporaine avec Soukeyna Konaré, connue pour ses passes d’armes avec Lamine Gueye, tout-puissant premier président de l’Assemblée nationale sénégalaise. Ces éléments factuels démontrent l’importante place accordée à la femme dans la société sénégalaise d’antan, mais sont surtout la preuve que les femmes ont toujours semé des germes de changement solides.
C’est fort de cet héritage socio-historique que plusieurs mouvements féministes et organisations féminines ont fait leur apparition vers les années 70 et 80 : l’Association des juristes sénégalaises (AJS, 1974), la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS, 1977), l’Association des femmes pour la recherche et le développement (AFARD, 1977), le mouvement Yewu Yewi (1984), etc. Grâce à ce bouillonnement associatif et intellectuel, le Sénégal procédera à la ratification de l’ensemble des conventions relatives aux droits des femmes et jettera les bases politiques et juridiques pour l’égalité femme-homme (SNEEG). Force est donc de reconnaître que les transformations sociales et politiques apparues au Sénégal, impulsées par les combats féministes, ont permis une meilleure représentation des femmes dans les institutions dirigeantes, l’intégration du genre dans les politiques de développement, et la mise en place de mécanismes de promotion féminine.
Cependant, malgré ces avancées considérables sur le plan institutionnel, l’absence d’une rupture dans la question de la subordination dans les rapports de genre est palpable. La marginalisation des femmes demeure un fait social indéniable. Ce hiatus entre une base culturelle favorable à la femme et une réalité contemporaine qui l’oppresse s’expliquerait par quelques tournants historiques marquants qui ont quelque peu « déstructuré » le système social sénégalais. Il s’agit de l’arrivée de religions étrangères et de la colonisation française.
Les figures féminines mentionnées plus haut (Ndatté Yalla, Aline Sitoe Diatta), ainsi que la pratique matriarcale de la société wolof, s’effacèrent au contact de ces apports culturels et cultuels, entraînant une domination patriarcale. Le mauvais procès fait à la cause féministe proviendrait alors de l’interprétation arbitraire faite par des hommes de certains textes religieux et d’un legs colonial inadapté aux réalités culturelles locales.
La transposition de modèles culturels prônant l’exclusion des femmes du système politique et de la sphère décisionnelle, ainsi que la négation de l’accès à la terre pour ces dernières (inspirée, par exemple, de la loi salique du XIVe siècle), a dilué le « pouvoir » des femmes. Cet état de fait se poursuivra jusqu’après les indépendances et s’incrustera dans l’espace socioculturel. Les femmes sont de plus en plus confrontées à des obstacles d’ordre structurel causés par des lois et des institutions discriminatoires (par exemple, le Code de la famille de 1972), qui réduisent leurs possibilités d’entrer pleinement dans l’exercice de leurs droits humains.
À titre illustratif, plusieurs dispositions du Code de la famille confèrent un total pouvoir à l’homme au sein du foyer, au détriment de la femme. Ces dispositions sont aujourd’hui encore sujettes à une forte polémique. Il est à noter que ces lois ne tiennent pas seulement compte de l’univers socioculturel sénégalais, mais s’inspirent fortement de références juridiques occidentales et arabo-musulmanes qui, loin de s’opposer totalement à la réalité coutumière locale, contredisent une bonne partie des valeurs et pratiques socioculturelles habituelles.
L’arrivée de religions étrangères a bouleversé le cadre socioculturel sénégalais. En effet, l’interprétation faite des textes religieux prône une classification sociale foncièrement orientée vers le patriarcat. À croire que « la réaction est humaine de se donner une large portion quand on partage le gâteau ». Ce n’est donc pas une surprise si les hommes ont conféré à leur genre les pleins pouvoirs sur les plans politique, social et financier, en « s’appuyant », selon eux, « sur des recommandations religieuses ». Une multitude de règles restrictives concernant la liberté d’expression, l’exercice du pouvoir et la participation à la vie politique sont désormais appliquées aux femmes, « au nom de la religion ». Elles se voient ainsi retirer des espaces de décision communautaires et familiaux.
L’imaginaire sénégalais voudrait que les femmes soient habilitées à se conformer à une interprétation plus ou moins « erronée » de nos références religieuses. Cette posture implique implicitement une annihilation d’un mouvement revendicatif des droits des femmes et donc de la pensée féministe. Le contexte socio-historico-politique est une preuve concrète du retrait des femmes de l’espace politique et du refus opposé à leur désir de parole. Le Pr Saliou Ngom révèle, à cet effet, que la plupart des recherches faites sur la participation politique des femmes distinguent une période d’exclusion, symbolisée par l’absence des femmes dans les instances de décision dans les années 70, et une période d’inclusion, impulsée par les mouvements féministes et les politiques d’empowerment.
« Au nom de la religion », qu’elles se taisent et qu’elles n’aient droit à la parole que lorsqu’elles y sont autorisées !
Plusieurs chercheurs, dont Zahra Ali, s’interrogent. Dans son ouvrage intitulé « Je suis musulmane et féministe, ne soyez pas surpris ! », elle pose cette problématique :
« En tant que musulmane pratiquante et féministe convaincue, j’aimerais que tous ceux qui nient la possibilité de mon existence commencent tout d’abord par se demander pourquoi penser que “l’islam est une religion patriarcale” leur paraît si évident. D’où leur vient cette certitude selon laquelle l’islam – plus que toute autre religion – serait par définition inégalitaire et oppressif à l’égard des femmes ? »
Tant de questions qui méritent des réponses plausibles, concrètes et réalistes dans une société comme la nôtre, qui continue d’alimenter une polémique antiféministe mue par une ignorance totale des fondements de ladite pensée.
En réalité, le féminisme est et demeurera une lutte acharnée d’une poignée de femmes et d’un soupçon d’hommes pour l’atteinte, d’abord, des droits humains des femmes, de leur dignité humaine, de leurs libertés individuelles, et du respect de leur condition de femme avec tout ce que cela comporte comme singularité caractérielle, particularité et spécificité des besoins. Le féminisme représente aussi ce mouvement féminin, capable de mettre à nu les failles d’une communauté humaine qui, en lieu et place d’une promotion de l’équité et de l’égalité des genres, creuse les écarts entre ces derniers en magnifiant des pratiques juridico-institutionnelles néfastes et en s’auto-glorifiant d’un patriarcat funeste, au détriment d’une égale dignité entre les femmes et les hommes.
Aujourd’hui, après plusieurs siècles de combats et avec en poche la consécration de l’égalité des droits entre les sexes en politique et dans la vie publique par l’article 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979, les inégalités salariales persistent, et la non-effectivité ou l’application partielle de plusieurs acquis juridiques (droit à l’avortement, criminalisation du viol, parité, etc.) restent d’actualité. La démocratie, telle que pratiquée au Sénégal, et le système politique en général sont de loin favorables à l’exercice des droits des femmes. Les écarts entre les genres sont davantage creusés par des pratiques institutionnelles auxquelles s’ajoutent des facteurs socioculturels qui ne favorisent pas la représentation des femmes dans les hautes instances. L’engagement politique des femmes a toujours été prégnant, mais tarde toujours à se traduire par une occupation réelle de postes politiques.
« On ne naît pas femme, on le devient », disait Simone de Beauvoir, en faisant référence au processus de structuration des rôles et rapports de genre dans les sociétés. Cette assertion trouve un sens profond dans la modélisation des rôles au Sénégal, où la « coutume » voudrait qu’on naisse fille, qu’on grandisse prédisposée à être une femme mariée, qu’on vive une vie d’épouse modèle et qu’on meure mère. Aucune marge n’est laissée à la possibilité de faire éclore un potentiel leadership féminin propice au développement économique et à la réinvention des savoirs. Au contraire, l’exercice d’acquisitions de savoir-faire, de savoir-être, de comportements et d’habitus tourne autour d’une volonté marquée de façonner « une femme vertueuse » exempte de tout désir, allant à l’encontre de la recherche d’ « un bon mari » capable de subvenir à ses besoins, à qui elle vouera sa vie terrestre et duquel dépendra son « bonheur dans l’autre monde ».
Cette « règle sociale » doit cesser à tout prix. Nous ne devons plus souscrire à une annihilation des droits de la plus grande moitié de la population humaine. Et parce qu’ « en tant que femme, nous devons montrer notre taux d’utilité nationale », comme le dit Mme Nafissatou Wade, je reste formellement persuadée que les luttes féministes ont leur place dans la marche continue de notre pays. Il est temps de mettre fin à des siècles de perpétuation de pratiques discriminatoires, de violences physiques, morales et psychologiques basées sur le genre, ainsi que d’inégalités sociales grevant l’économie.
Ceci passe par une réappropriation de nos valeurs culturelles pré-coloniales, par la revivification de « notre histoire » – l’histoire de l’Afrique et du Sénégal – racontée par nous-mêmes, par nos voix autorisées, et par nos écrits consacrés. En réalité, l’histoire – en tout cas, la bonne version – est indispensable dans la lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles au Sénégal. Elle est importante en cela qu’elle reste le seul moyen d’édifier le peuple sur la véritable structure de son système social.
En effet, l’Occident n’a rien à nous apprendre, et nous « n’avons personne à rattraper » en termes de leadership social inclusif et représentatif. Avec le matriarcat longtemps appliqué par la société wolof, l’existence des « ndey ji rew » et le rôle légendaire joué par nos reines et résistantes avant l’avènement des colons, nous avons toujours eu des femmes et des hommes valeureux.
Notre histoire, qui commence bien avant l’avènement des religions venues d’ailleurs, nous prouve à plus d’un titre que notre système social était loin d’être inégalitaire.
Cela nous amène à dire que le fondement de la pensée féministe des Africaines de l’Ouest, et particulièrement des Sénégalaises, ne devrait pas se focaliser sur une acquisition de droits, mais plutôt sur une réappropriation de ceux-ci.
Loin de moi l’idée de « diviser » les féministes et les féminismes, mais il se trouve que chaque lutte détient intrinsèquement une origine légitime, un fondement historique. Ceux du féminisme ouest-africain devraient résider dans le rétablissement du statut des femmes lors de la période précoloniale, la réappropriation des droits jadis détenus par celles-ci, et leur réinsertion dans le système politique, avec comme seule référence le système socio-culturel sénégalais, voire africain.
Ce féminisme se veut revendicatif des droits des femmes sans aller à l’encontre du culte religieux, sans « déshabiller » les femmes, sans leur ôter les multiples fonctions sociales que la tradition africaine et sénégalaise leur assigne, tout en leur reconnaissant une réelle capacité à formuler une pensée, une pensée libre, capable de déconstruire les préjugés inégalitaires et de construire un monde meilleur.
Ce féminisme s’identifie partiellement à Simone de Beauvoir : il magnifie sa bravoure, son innovation, loue la noblesse de son combat, mais réfute l’appel à la « dépravation » ainsi que le rejet de l’institution qu’est le mariage. Il en est de même pour la forme de revendication des Femen, qui ne saurait être conforme aux valeurs traditionnelles africaines.
Des féminismes, il en existe ! Leurs formes de revendications peuvent diverger, tout comme leurs fondements théoriques, mais le socle de ladite pensée reste le même : celui de l’établissement d’une société où les femmes et les hommes sont égaux devant les institutions, la grille salariale, la structure juridique et « l’œil sociocommunautaire ».
Vingt-cinq ans après Beijing 95, des disparités existent toujours au sein de nos communautés. Des avancées sont certes notées, mais il persiste un large éventail de lacunes à combler. Cependant, une nouvelle génération de féministes est née : une génération qui s’attèle à l’écriture, à la pensée, aux actions et au changement !
Une génération qui s’identifie à une référence féminine africaine, noire et contemporaine, qui s’inspire de figures telles que Mariama Bâ, Annette Mbaye d’Erneville, Ndeye Arame Diène, Marie-Angélique Savané, Ndioro Ndiaye, Chimamanda Ngozie Adichie, etc. Une « brand new generation of feminists » qui a compris qu’il est possible d’allier ses convictions religieuses à ses convictions politiques, et qui n’hésite pas à interroger les textes religieux, l’histoire et la réalpélitique afin de restructurer les sociétés africaines modernes.
Cette génération agit pour que les générations futures ne souffrent d’aucune discrimination et que l’égalité prime sur tout.